Les supports francophones concernant l’étude de l’ADN environnemental ne sont pas courants, aussi je profite de ma lecture récente du livre « Environmental DNA » chez Oxford pour produire ce billet d’illustration sur le sujet de l’ADN environnemental comme moyen de surveillance et d’étude des écosystèmes. Le livre présente une introduction pointue et actuelle sur le sujet, mais il s’adresse spécifiquement à des chercheurs du domaine.
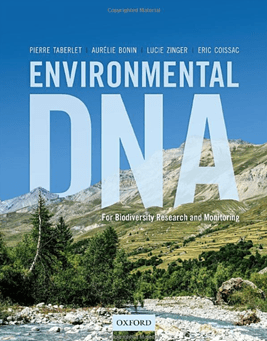
Bien entendu l’étude de l’ADN environnemental n’est pas une chose fondamentalement nouvelle, mais son développement a été relativement lent, avec une véritable émergence comme champ disciplinaire constitué aux alentours de 2010. Les premiers travaux dans le domaine ont émergés dans les années 80, et les technologies facilitant grandement cette approche de l’étude des écosystèmes sont arrivées sur le marché en 2005. En dehors du coût prohibitif de ces technologies lors de leur mise sur le marché, la lente émergence du domaine peut être rapportée à divers facteurs, depuis le challenge technique représenté par l’extraction de molécules d’ADN présentes dans un échantillon environnemental (comme du sédiment ou l’eau d’un étang), à la dimension transdisciplinaire de l’approche, alliant notamment écologie et génétique.
De fait, l’ADN environnemental consiste en une mixture complexe de l’ADN provenant de nombreuses espèces différentes, ainsi que d’une matrice potentiellement néfaste à l’analyse (càd la fraction organique et inorganique de l’échantillon qui n’est pas l’ADN que l’on recherche). Dans un échantillon environnemental, l’ADN est de surcroît fortement dilué et fragmenté, contrairement à ce que l’on trouverait dans un échantillon de tissus frais ou préservés (comme un échantillon salivaire contenant des cellules de peau, pleines d’ADN parfaitement préservé). Ces difficultés techniques peuvent être augmentées si l’on désire en outre étudier des écosystèmes anciens, le passage du temps n’arrangeant rien à la dégradation des molécules recherchées.
Le domaine a d’abord été investi par les microbiologistes, qui voyaient là la possibilité d’identifier et étudier des espèces qu’ils ne pouvaient cultiver en boites de Petri. Ainsi en 1987, Ogram et ses collègues publient le premier article scientifique proposant l’extraction et la purification d’ADN microbien depuis des échantillons de sédiments (Ogram et al., 1987). Dans le courant des années 90, d’autres microbiologistes s’essayent à d’autres cibles dans différents milieux, comme les communautés bactériennes des sources chaudes d’Octopus Spring dans le parc de Yellowstone (Ward et al., 1990) ou la diversité génétique du bactérioplancton dans la mer de Sargasse (Giovannoni et al., 1990). Les papiers restent cependant rares pendant toute la décennie (et toujours bien investis par les microbiologistes). En 1998 apparait une notion importante, celle de métagénome du sol (Handelsman et al., 1998). L’idée n’est pas seulement d’identifier des espèces inconnues, mais également de nouvelles voies de synthèses de molécules bioactives chez ces microbes inconnus.

Il faut encore attendre le courant des années 2000 pour véritablement voir se généraliser avec succès l’approche environnementale, notamment pour l’identification de la macrofaune. Un exemple peut en être donné par la détection en étendues d’eau douce de l’ADN de la grenouille-taureau nord-américaine Rana catesbeiana (Ficetolla et al., 2008). Les auteurs montrèrent non seulement la possibilité de détecter l’ADN de ces organismes supérieurs (par distinction d’avec les bactéries) dans des échantillons environnementaux (ici de l’eau douce), mais qu’il pouvait en outre s’agir d’un excellent outil de suivit des espèces invasives (comme la grenouille-taureau).
Un autre papier précurseur dans le domaine à certainement été celui de Willerslev et ses collègues (2003). Celui-ci avait pour originalité non seulement de rechercher une large diversité d’espèces dans des écosystèmes terrestres (depuis des échantillons de sédiment), mais de surcroit des écosystèmes passés comportant notamment des espèces éteintes comme le mammouth ou le moa de Nouvelle-Zélande.
Un bref aperçu des travaux précurseurs montre bien également l’étendue des milieux et des cibles potentiels de ce type d’approche. L’un des plus étudiés à l’heure actuelle concerne certainement les milieux d’eau douce. Martellini et ses collègues (2005) s’étaient déjà intéressés à la détection de pollutions d’origine fécale humaines ou non humaines (comme les animaux d’élevage) dans les eaux douces de surface. Ficetolla et collègues (2008) ont quant à eux montré le potentiel de l’approche en termes de monitoring comme nous l’avons vu précédemment, offrant un nouvel outil à l’arsenal de suivi, de conservation et de restauration des milieux humides.

Retrouver l’ADN de la faune ou de la flore peuplant une étendue d’eau douce n’est cependant pas évident, et dépend de plusieurs facteurs, depuis la production de cet ADN à son transport et sa détectabilité en passant par sa persistance dans le milieu. Certains biais semblent ainsi intuitifs, comme une difficulté accrue à détecter des espèces rares, ou la possibilité de détecter l’ADN d’espèces allochtones ne peuplant pas réellement le milieu, via la percolation de pollutions fécales par le ruissèlement des eaux de pluie par exemple. Les conditions pouvant par ailleurs fortement varier d’un milieu à l’autre, il n’est jamais évident que des résultats positifs dans l’un d’eux, à la recherche d’un taxon particulier, soient aisément transférables à un autre.
Il semble néanmoins bien établi que l’ADN persiste dans l’eau douce plusieurs jours voire plusieurs semaines avant de devenir indétectable. Dejean et ses collègues (2011) l’on illustré en milieu contrôlé (aquariums) et en milieu naturel. Les chercheurs ont ainsi pu quantifier la persistance de l’ADN de têtards de grenouilles-taureaux en aquarium et d’esturgeons en milieu naturel. Ces travaux, plusieurs fois confirmés, ont contribué à valider l’approche pour le suivi d’espèces invasives ou en danger. Il est par ailleurs apparu qu’elle se montrait complémentaire voire plus efficace que les approches traditionnelles, par exemple lors du suivi des populations de moustiques.
Les écosystèmes marins sont encore beaucoup moins étudiés, mais donnent également nombre d’exemples étonnants et importants de recherche. Plus que la grande dilution, il ne faut pas sous-estimer là la diversité des sous-systèmes composant le milieu marin : les eaux profondes, les estuaires, les récifs coralliens, les eaux de surface, ne sont qu’une petite illustration de la diversité des milieux marins pouvant grandement faire varier les paramètres de préservation, de mobilité et de détectabilité de l’ADN. Un exemple éloquent de la recherche en ce type de milieux peut être celui de l’étude de Sigsgaard et collègues (2016), qui ont pu détecter dans le Golfe Persique l’ADN de requins-baleines (Rhincodon typus). Non seulement cette détection était positivement corrélée à celle de l’ADN de la thonine orientale (Euthynnus affinis), un petit poisson constituant l’une des sources principales d’alimentation de ce requin, mais également différents haplogroupes du requin. En clair, il était possible pour les chercheurs de détecter en plein océan des zones d’agrégation récente des requins chassant leur proie principale et la diversité génétique de cette population de prédateurs.


Les milieux terrestres quant à eux, offrent leurs propres spécificités, qu’il s’agisse des milieux actuels ou anciens, ce que j’ai déjà pu aborder sur ce blog (ici ou là). Un exemple récent a été celui du suivi des populations de renards de San Joaquin en Californie où la collecte minutieuse des crottes de ce petit canidé a permis d’en étudier la composition (comme le sex-ratio), la structure génétique et la répartition, tout ceci de manière non invasive (puisque la collecte ne nécessite pas de capture), et menant à l’orientation de stratégies de conservation de l’espèce dans cette région.
Les potentialités de l’étude de l’ADN présent dans les échantillons environnementaux (sol, sédiment, litière, eau douce, eau de mer, fèces…) sont donc nombreuses. Cette approche pose certes un certain nombre de problèmes techniques, depuis la stratégie d’échantillonnage jusqu’au traitement bio-informatique des données et leur interprétation biologique, mais également des perspectives encore quasi inexplorées. L’étude non invasive des populations animales en danger ou la détection d’espèces exotiques, rares, ou vectrices de pathogènes ne sont que quelques exemples.
Références :
- Dejean et al., 2011, Persistence of Environmental DNA in Freshwater ecosystems. PLoS ONE 6(8):e23398.
- Ficetolla et al., 2008, Species detection using environmental DNA from water samples. Biol Lett. 23 ;4(4) :423-5.
- Giovannoni et al., 1990, Genetic diversity in Sargasso Sea bacterioplankton. Nature 345, 60-63.
- Handelsman et al., 1998, Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes. Chemistry & Biology 5(10):R245-R249.
- Martellini et al., 2005, Use of eukaryotic mitochondrial DNA to differentiate human, bovine, porcine and ovine sources in fecally contaminated surface water. Water Research 39:541-548.
- Ogram et al., 1987, The extraction and purification of microbial DNA from sediments. Journal of Microbiological Methods 7:57-66.
- Sigsgaard et al., 2016, Population characteristics of a large whale shark aggregation inferred from seawater environmental DNA. Nature Ecology & Evolution 1,0004.
- Ward et al., 1990, 16S rRNA sequences reveal numerous uncultured microorganisms in a natural community. Nature 345:63-65.
- Willerslev et al., 2003, Diverse Plant and Animal Genetic Records from Holocene and Pleistocene Sediments. Science 2;300(5620):791-5.
